|
Les figures multipliées ont nécessairement moins de largeur que les figures isolées. Quelquefois, elles présentent également la même particularité quand elles sont seules. Dans ce dernier cas, si leurs dimensions descendent au-dessous de certaines limites, elles changent de nom et constituent ce qu'on appelle des figures diminuées. Les pièces qui suivent appartiennent à cette catégorie.
1° La Vergette.
C'est un pal réduit au tiers de sa largeur.

Masy : D'or, au pal de sable chargé d'une vergette d'argent. |

Le François : D'azur, à cinq vergettes d'argent. (Normandie) (1) |

Rillac (de) : D'argent, à sept vergettes de
gueules. (Auvergne) |
|
2° Le Comble ou chef retrait.
On appelle ainsi un chef qui n'a que la moitié de sa hauteur ordinaire.
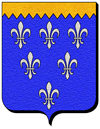
Kemmerër von Dalburg : D'azur, à six fleurs de lis d'argent, 3, 2, 1 ; au comble d'or, denché. |
|
3° La Divise ou Fasce en divise.
C'est une fasce réduite au tiers de sa hauteur. Elle est seule, tandis que les burelles avec lesquelles on pourrait la confondre, sont toujours en nombre. Elle soutient généralement un chef ou bien un chef la surmonte.

Yver de Saint-Aubin : D'azur, à une divise d'or accompagnée de trois étoiles du même, deux en chef et une en pointe. (Poitou) |
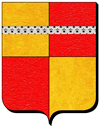
Mirabel : Écartelé d'or et de gueules, à la divise d'hermine brochant sur les deux premiers quartiers. (Dauphiné) (2) |
4° Les Jumelles.
On donne ce nom à deux fasces rétrécies et posées deux à deux, qui occupent, dans l'écu, le même espace que la fasce. Elles se posent, non seulement en fasce, c'est le cas le plus ordinaire, mais encore en bande, en barre ou en sautoir. Quand elles ne sont pas en fasce, il faut le spécifier en blasonnant.

Gouffier (de) : D'or, à trois jumelles de sable. Devise : Hic terminus haeret. (Poitou, Bourgogne)
|

Hérouville (d') : De gueules, à deux jumelles d'argent. (Normandie) |

Rubempré (de) : D'argent, à trois jumelles de gueules. (Picardie) |
|
5° Les Tierces.
Ce sont trois fasces diminuées et groupées trois à trois comme les jumelles deux à deux. Elles se placent horizontalement sur le champ de l'écu. Quand, ce qui arrive quelquefois, on les met en bande, en barre ou en sautoir, on doit l'exprimer en blasonnant.

Pellot du Portdavid : De sable, à la tierce d'or. (Barrois, Lyonnais)
|

Budes des Portes : D'azur, à la tierce d'or en bande. (Languedoc) |

Bourbourg : D'azur, à trois tierces d'or. (Picardie) (fig. 67). |
|
6° L'Étai.
C'est un chevron qui a perdu les deux tiers de sa largeur ordinaire.

Recourt de Rivière (de) : De gueules, à l'étai d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, et soutenant une fasce en divise aussi d'or, surmontée de trois étoiles du même. (Bourgogne) |
|
7° Les Croisettes.
Ce sont des croix diminuées qui ne touchent pas les bords de l'écu. Elles sont le plus souvent en nombre.
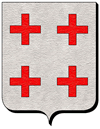
Angély : D'argent, à quatre croisettes de gueules. (Limousin) |
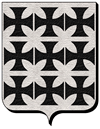
Louvetel de Saint-Thomas : D'argent, à neuf croisettes pattées de sable. (Normandie, Bretagne) |
8° Le Flanchis.
On appelle ainsi un petit sautoir alésé qui meuble l'écu ou qui charge une pièce honorable ; il est presque toujours en nombre.
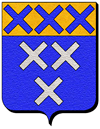
Balsac alias Balzac d'Entragues (de) : D'azur, à trois flanchis d'argent ; au chef d'or, chargé de trois flanchis d'azur. (Rouergue) |
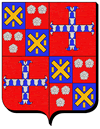
L'Aubépine de Châteauneuf (de) alias L'Aubespine (de) : Écartelé : aux 1 et 4, contre-écartelé : a. et d. d'azur, au flanchis d'or, cantonné de quatre billettes du même ; b. et c. de gueules à trois fleurs d'aubépine d'argent ; aux 2 et 3, de gueules, à la croix ancrée de vair. (Beauce, Bretagne, Bourgogne) |
9° La Cotice.
On donne ce nom à une bande diminuée, qui n'a, suivant les uns, que les deux tiers, suivant les autres, que la moitié de la largeur ordinaire de la bande. Tantôt, elle est seule ; tantôt il y en a deux, trois, quatre ou cinq.
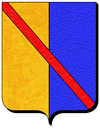
Talaru (de) : Parti d'or et d'azur, à la cotice de gueules brochant sur le tout. (Forez) |

Souvré de Courtanvaux (de) : D'azur, à cinq cotices d'or. (Perche) |

Saint-Loup (de) : D'or, à trois cotices de gueules. (Lorraine) |
|
10° La Traverse.
Ce n'est autre chose qu'une barre rétrécie. On l'appelle quelquefois contre-cotice.
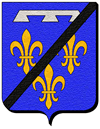
Orléans-Longueville Dunois (d') : D'Orléans, à la traverse de sable. (6) |
|
41° Le Bâton.
C'est une cotice ou une traverse dont les extrémités ne touchent pas les bords de l'écu, Il se nomme bâton péri en bande dans le premier cas, et bâton péri en barre dans le second cas. Ces deux pièces se posent au centre de l'écu et s'emploient comme brisure.
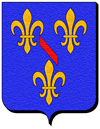
Bourbon-Condé (de) : De France, au bâton péri en bandée gueules. |
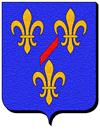
Bourbon-Penthièvre (de) : De France, au bâton péri en barre de gueules. |
12° Le Filet.
On appelle ainsi toute pièce honorable qui est réduite à sa plus simple épaisseur, mais cette expression est surtout usitée pour la barre, la bande et la croix.
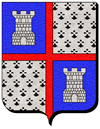
Fosez : Écartelé : aux 1 et 4, d'azur, à la tour d'argent ; aux 2 et 3 d'hermine ; au filet de gueules en croix brochant sur le tout. |
|
13° La Filière.
On donne ce nom a une bordure très étroite. Elle se distingue de l'Orle en ce qu'elle touche le bord de l'écu, ou la bordure quand il y en a une, tandis que, outre qu'elle est plus large, l'Orle est séparée de l'écu par un vide égal à sa largeur.
14° La Plaine.
C'est une Champagne réduite au tiers de son épaisseur. Elle se termine supérieurement par une ligne horizontale, ce qui la distingue, de même que la Champagne, de la Terrasse, qui est sinueuse et couverte d'aspérités. C'est, du reste, une pièce très rare en armoiries.

Petite-Pierre (de) : De gueules, au chevron d'argent, à la plaine d'or. (Bourgogne) |

Sturmeck : D'or, à la fasce de gueules, à la plaine du même. (Alsace) |
|
