|
fil
On compte quatorze pièces moins honorables ou de deuxième ordre, savoir :
L'Émanché, — l'Échiqueté, — les Points équipollés, — les Frettes, — le Treillis, — les Losanges, — les Fusées, — les Mâcles, — les Rustres, — les Billettes, — les Besants, — les Tourteaux, — les Besants-Tourteaux, — les Tourteaux-besants, — et les Carreaux.
1° Émanché. — La pièce de ce nom se compose de grandes dents triangulaires, alternativement de métal et de couleur, enclavées les unes dans les autres, réunies par la base, et mouvantes de l'un des côtés ou de l'un des angles de l'écu.
On distingue l'émanché en pointe, en pal, en chef, renversé, en bande, en barre, etc. ; en blasonnant, il faut dire le nombre de dents, de pointes ou émanches.

Hotman de Villiers (d') alias Hotteman : Parti emmanché d'argent et de gueules, à quatre (ou six) pièces. |
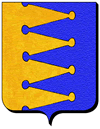
Abon (d') : Parti émanché d'or et d'azur, à quatre pièces, les extrémités pommetées alias coupé-émanché d'or et d'azur de trois pièces et demie, les extrémités pommetées. Devises : Union maintient et Tenet mensuram. Supports : Deux lions. (Dauphiné, Provence)
|
2° On appelle Échiqueté la réunion de plusieurs rangées ou tires, de petits carrés alternativement de métal ou de couleur ou de couleur et de métal, qui sont disposés comme les cases de la table du jeu des échecs. Régulièrement, il doit y avoir six rangées, ce qui fait trente-six carreaux. S'il y en a moins, il faut le spécifier en blasonnant. Dans tous les cas, le nombre des carreaux doit être de vingt au moins. S'il n'était que de quinze, on dirait à quinze points d'échiquier.
Dans tout échiqueté, le premier carreau est celui de l'angle dextre de l'écu, et c'est l'émail de ce carreau que l'on nomme le premier.

Ventadour (de) : Échiqueté d'or et de gueules. (Limousin)
|

Courcelles (de) : Échiqueté d'or et de gueules. (Poitou) |

Noë : Échiqueté d'or et de gueules. (Languedoc) |
|
3° Points équipollés. — Ce sont neuf carreaux dont cinq de métal (les quatres des angles et celui du milieu) et quatre de couleur, ou réciproquement.
Comme pour l'échiqueté, on commence, en blasonnant, par celui qui occupe l'angle dextre de l'écu.

Saint-Priest d'Urgel (de) : Cinq points d'or, équipollés à quatre d'azur. (Dauphiné, Forez)
|

Gentil (de) : Cinq points d'azur, équipollés de quatre d'or. (Aunis, Saintonge) |
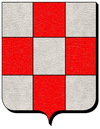
Boisy (de) : Cinq points d'argent équipollés, à quatre de gueules. (Bourgogne) |
|
4° Frettes. — Les pièces de ce nom résultent de la réunion de six cotices entrelacées en diagonale, trois en bande, trois en barre, leurs extrémités ne touchant pas d'ordinaire les côtés de l'écu. Il n'y a quelquefois que qutre cotices. Il peut y en avoir également huit, mais jamais davantage. Les pièces de ce genre sont peu communes. Quand il en existe dans un écu, on dit le plus souvent qu'il est fretté.

Mesnard alias Maynard : D'argent, fretté d'azur. Devise : Pro Deo et Rege. (Poitou)
|

La Motte de Motte-Rouge (de) : De sable, fretté d'or de six pièces. (Bretagne) |

Latier de Bayane (de) : D'azur, à trois frettes d'argent, au chef du même. Devise : Pour trois. (Dauphiné) |
|
5° Treillis. — Ces pièces présentent la même disposition générale que les frettes, sauf que les cotices sont au nombre de dix ou douze et que, de plus, elles sont simplement posées les unes sur les autres et non entrelacées. Elles sont excessivement rares dans le blason français. On emploie le mot treillissé pour exprimer qu'il y a, sur un écu ou une pièce honorable, plus de huit cotices ainsi disposées.
6° Losanges. — Ce sont des pièces en forme de carré allongé. Ils ont leurs côtés égaux et parallèles, avec deux angles obtus et deux angles aigus, et se posent ordinairement sur l'un de ces derniers.
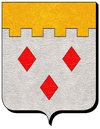
Belot-Villette (de) : D'azur, à trois losanges d'argent, au chef bastillé cousu d'or de quatre pièces. (Franche-Comté) |
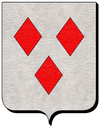
Lespinay de Marteville (de) : D'argent, à trois losanges de gueules. (Picardie) |
7° Fusées. — On appelle ainsi les losanges très effilés. On leur donne deux parties de largeur et quatre de hauteur, et on les pose généralement sur un de leurs angles aigus.

Saint-Nectaire (de) : D'azur, à cinq fusées d'argent, en fasce. (Auvergne) |
|
8° Mâcles. — Ce sont des losanges percés à jour d'une ouverture, également en losange, qui laisse voir le champ de l'écu. Quand il n'y en a qu'une, elle doit avoir en largeur deux parties et un tiers des sept parties que présente la largeur de l'écu, et en hauteur, une huitième partie de plus prise sur les deux parties un tiers.
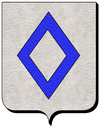
Tréanna : D'argent, à la mâcle d'azur. (Bretagne)
|

Méaultis alias Méautis : De gueules, à trois mâcles d'or. (Normandie) |

Rohan (de) : De gueules, à neuf macles d'or. Devises : 1° à plus ; 2° Roi ne puis, Prince ne daigne, Rohan suis. (Bretagne) |
|
9° Rustres. — Ce sont également des losanges percés au milieu comme mes mâcles, mais avec cette différence que leur trou est rond et non en losange.
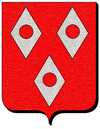
Schenaye : De gueules, à trois rustres d'argent. (Flandre) |
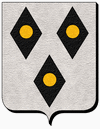
Montfort-Taillant (de) : D'argent, à trois rustres de sable, remplis d'or. (Franche-Comté) |
10° Billettes. — On appelle ainsi des pièces en forme de carré long et de petites dimensions. Elles se posent ordinairement d'aplomb, c'est-à-dire sur un de leurs petits côtés. Quand elles sont horizontales, ce qui est rare, on les dit couchées ou renversées. On les emploie quelquefois percées en rond ou en carré, ce qu'il faut préciser.
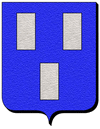
Billy (de) : D'azur, à trois billettes d'argent. (Lorraine) |
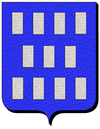
Beaumanoir de Lavardin (de) : D'azur, à onze billettes d'argent, 4, 3, 4. Cri : Bois ton sang, Beaumanoir ! Devise : J'ayme qui m'ayme. (Bretagne, Maine)
|
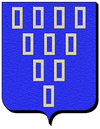
La Bédoyère (de) : D'azur, à six billettes vidées d'argent. (Bretagne) |
|
11° Besants. — Figures rondes, plates et pleines, qui sont toujours de métal, c'est-à-dire d'or ou d'argent. Les anciens héraldistes donnaient quelquefois à ceux d'argent le nom de plates, du mot plata qui signifie en espagnol argent.
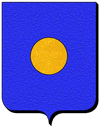
Aymond de Montepin : D'azur, au besant d'or. (Bresse) |

La Touche de La Limousinière (de) : De gueules, à trois besants d'or.
|
12° Tourteaux. — Ce sont aussi des pièces rondes, plates et pleines, mais qui diffèrent des besants en ce qu'elles sont toujours de couleur ou de fourrure..
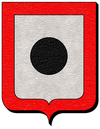
Montsalvy (de) : D'argent, à un tourteau de sable, à la bordure de gueules. (Auvergne) |
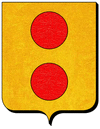
Montesquiou de Fezensac (de) : D'or, à deux tourteaux de gueules, l'un sur l'autre. (Gascogne)
|
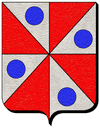
Guiton : Gironné d'argent et de gueules, chaque giron d'argent chargé d'un tourteau d'azur. (Bourgogne) |
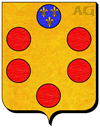
Médicis (de) : D'or, à cinq tourteaux de gueules, 2, 2, 1, surmontés d'un tourteau d'azur, chargé de trois fleurs-de-lys d'or.
|
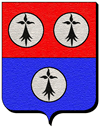
Carbonnel de Canisy (de) : Coupé de gueules sur azur, à trois tourteaux d'hermine. (Normandie) |
|
Obs. Les anciens auteurs donnent quelquefois des noms particuliers aux tourteaux, suivant leurs couleurs. Ainsi, ils appellent guses ceux de gueules, heurtes ceux d'azur, pommes ou volets ceux de sinople, ogoesses ceux de sable, gulpes ceux de pourpre.
13° Besants-tourteaux. — Ce sont encore des pièces rondes, plates et pleines. Ce qui les distingue des deux sortes précédentes, c'est qu'ils sont moitié de métal et moitié de couleur, la partie métallique à dextre ou en chef et la partie de couleur à senestre ou en pointe. Ils se placent toujours sur un champ de couleur, et on les dit coupés ou partis, suivant leur position.

Fuensalda : De gueules, à six besants-tourteaux d'argent et de sable, posés 2, 2, 2, les 1 et 3 à dextre et le 2 à senestre coupés, et les 3 autres partis. (Espagne) |
|
14° Tourteaux-besants. — Ce sont encore des pièces semblables aux précédentes, dont elles ne diffèrent que parce que leur partie métallique est à senestre ou en pointe. Ils se mettent toujours sur un champ de métal.
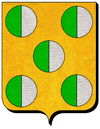
Angullos : D'or, à cinq tourteaux-besants partis de sinople et d'argent mis en sautoir. |
|
15° Carreaux. — Comme leur nom l'indique, ce sont des figures en forme de carré parfait. Ils se posent sur un de leurs côtés. On les rencontre beaucoup plus rarement que les autres pièces.
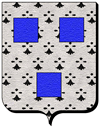
Carrel alias Carel : D'hermine, à trois carreaux d'azur alias de gueules. (Normandie) |

Carrey de Bellemarre (de) : D'azur, à la bande d'or, chargée de trois carreaux de sable, et accompagné de deux molettes d'éperon du même. (Normandie)
|
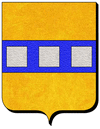
Chomel : D'or, à la fasce d'azur, chargée de trois carreaux d'argent. (Île-de-France) |
|
|
