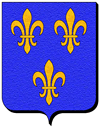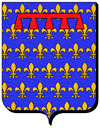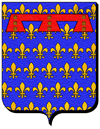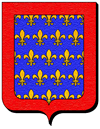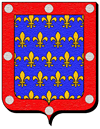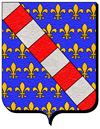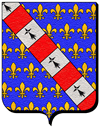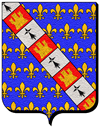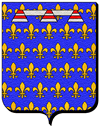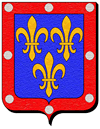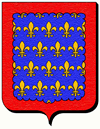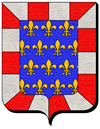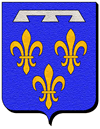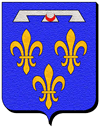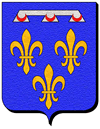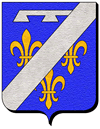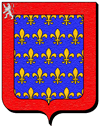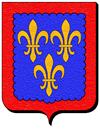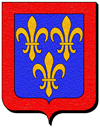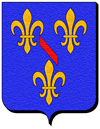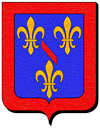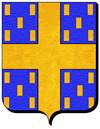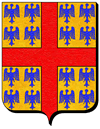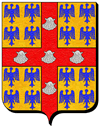|
||
 |
||
Brisure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRISURE. On entend par Brisure, l'addition, la diminution ou l'altération de quelque pièce dans les armoiries d'une famille. La Brisure sert à distinguer les différentes branches d'une maison, la branche aînée porte seule les armes pleines et primitives. On brise en ajoutant un lambel, une bordure, un bâton, un franc-canton, en écartelant d'un quartier d'alliance ; quelquefois on substitue un meuble à un autre et enfin souvent on change les émaux. d'après l'Alphabet et figures de tous les termes du blason
L.-A. Duhoux d'Argicourt — Paris, 1899
BRISURE. C'est le mode adopté pour distinguer les écus communs à plusieurs branches d'une même maison ou ceux portés par les cadets et les enfants illégitimes. On se sert généralement du lambel, de la bordure, du bâton péri, du franc-canton ou d'une barre pour indiquer une Brisure. d'après le Dictionnaire archéologique et explicatif de la
science du blason Comte Alphonse O'Kelly de Galway — Bergerac, 1901 BRISURE. En termes de blason la Brisure est un changement dans les armoiries pour distinguer les branches d'une même famille. On peut briser de plusieurs manières différentes ; savoir, par le changement de toutes les pièces, en conservant seulement les émaux ; par le chancrement des émaux ; par le changement de la situation de quelques figures, ou par la diminution du nombre des pièces semblables ; par l'addition de quelque pièce nouvelle ou par l'accroissement du nombre des pièces semblables ; par les partitions ou les écartelures ; par le changement dans la forme des figures ; enfin par le changement des cimiers. La première manière a été fort en usage dans les commencements ; ainsi les ducs de Bourgogne de la première branche, les comtes de Vermandois et les comtes de Dreux, sortis de la maison de France, se contentèrent d'en retenir les émaux. Les ducs de Bourgogne portèrent bandé d'or et d'azur, de six pièces à la bordure de gueules. Les comtes de Vermandois portèrent échiqueté d'or et d'azur, au chef de France. Les comtes de Dreux, échiqueté d'or et d'azur, à la bordure de gueules. Cette manière de briser altérait tellement les armoiries qu'il n'était guère possible de reconnaître les familles qui brisaient ainsi. La seconde, qui se faisait par le changement des émaux, a eu aussi le même inconvénient depuis que le grand nombre de maisons qui portent des pièces semblables ne se distinguaient que par les émaux : aussi l'usage en est devenu très rare. Ainsi les Grolée de Bresse portaient gironné d'or et de sable ; ceux de Dauphiné portent gironné d'argent et de sable. Les Clermont de Dauphiné, de gueules à deux clefs en sautoir d'argent ; les Clermont de Savoie, qui ont la même origine, portent d'or à deux clefs en sautoir de sable. Les aînés de Maillé portent d'or à trois maillets de sinople ; ceux de cette maison établis en Bourgogne portent de gueules aux maillets d'or. D'autres branches portent d'or aux maillets de sable, d'or à trois maillets d'azur. Cette manière de briser était très commune dans les Pays-Bas, comme on le voit par les armoiries de différentes branches d'Arscriot, de Hornes, d'Enghien, etc., etc. La troisième manière se fait par le changement dans la situation des pièces. Les aînés de Bon, à Venise, portaient parti de gueules et d'argent ; les cadets portèrent parti d'argent et de gueules. Surian, coupé de sable sur argent à la croix ancrée de l'un en l'autre ; les puînés prirent coupé d'argent sur sable à la croix ancrée de l'un en l'autre. La quatrième manière se fait par le retranchement de quelqu'une des pièces différentes ou semblables. La maison de Foix, qui se disait issue de celle de Barcelone, portait de gueules à trois pals d'or. Les comtes de Barcelone en portaient quatre. La maison de Choiseul porte d'azur à la croix d'or cantonnée de vingt billettes, cinq dans chaque canton, rangées en sautoir : quelques branches cadettes brisent en retranchant deux de ces billettes dans les cantons de la pointe.
L'addition d'une pièce nouvelle aux armoiries pleines de la famille est la cinquième manière de briser, c'est aussi la plus commune et presque la seule en usage dans le royaume. Les princes du sang de France brisent tous de cette manière. Les pièces dont on se sert ordinairement pour Brisures sont le lambel, la bordure, le bâton péri, c'est-à-dire raccourci et en abîme, le canton, la molette d'éperon, le croissant, l'étoile, le besant, la coquille, la croisette, la tierce ou quintefeuille, et autres semblables, qui n'altèrent pas considérablement le blason principal.
L'accroissement des pièces semblables est une sorte de Brisure dont on trouve des exemples. La maison de Clare portait d'or à trois chevrons de gueules ; les comtes de Pembrok, cadets de cette maison, portèrent l'écu plein de chevrons. Le changement dans la forme des figures sert aussi de distinction. La maison de la Baume porte pour armes, d'or à la bande d'azur ; la branche de Mont-Revel porte cette bande vivrée pour distinctif. On peut encore briser en écartelant les armes de sa maison avec les armes d'une famille dans laquelle on a pris alliance ; ainsi Bourbon-Saint-Paul écartelait de Bourbon et de Luxembourg ; Orléans-Longueville écartelait de Longueville et de Bourbon. En Allemagne, les branches d'une famille ne se distinguent ordinairement que par les cimiers différents, soit par le nombre, soit par la forme. d'après le Dictionnaire héraldique
Charles de Grandmaison — Paris, 1861 BRISURE, subst. fém., pièce ou meuble qu'on ajoute aux armoiries pour distinguer les cadets d'avec les aînés des maisons. La bordure crénelée dans les armes d'Angoulême, le lambel dans celles d'Orléans, le bâton péri en bande dans celle de Condé, sont des Brisures. Le blason n'a que quatre termes pour désigner les Brisures ; ce sont les mots brochant, péri, en abîme, en coeur. Mais il y a beaucoup de maisons qui portent pour Brisures des pièces ou meubles que ces trois termes ne peuvent exprimer, et c'est sans doute pour cette raison que les Brisures ne s'expliquent pas en armoiries. En effet, on ne dira pas : Telle branche de telle famille porte : d'azur, à la croix d'or ; brisé de quatre coquilles d'argent ; on se servira du terme cantonnée. Il arrive souvent que des maisons portent pour Brisures des pièces honorables ; quand ces pièces ne brochent point, quoique Brisures, elles deviennent pièces principales, et s'expliquent avant les autres. Ainsi, au lieu de dire : Telle famille porte : de sable, à trois fleurs de lys d'or ; brisé d'un chevron d'argent, on dira : de sable, au chevron d'argent, accompagné de trois fleurs-de-lys d'or. On observe que la plupart des Brisures, quoique de métal sur métal ou de couleur sur couleur, ne donnent point sujet à s'enquérir, à moins que ce ne soient des pièces honorables. Voyez Enquerre. d'après le Dictionnaire encyclopédique
de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816 — Télécharger
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
||
|
|
| Plan du site Mises à jour Liens |
Identification d'un blason |
Certains meubles utilisés sont sous licence Wikimedia Commons