|
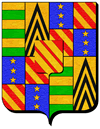 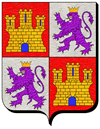 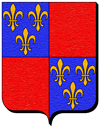 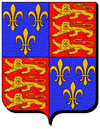 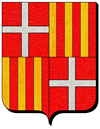
L'héraldique, ou science des armoiries, étudie les symboles peints, gravés ou dessinés, propres à chaque famille en possédant. Ces symboles ont pour support un écu formant un blason, qui peut être surmonté d'un cimier et, éventuellement d'une couronne, supporté par des animaux allégoriques (supports) ou des personnages (tenants), et illustré d'un listel où figure une devise. Cet ensemble constitue l'armoirie.
Hubert Lamant-Duhart, Armorial du Pays-Basque
Les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d'origine noble.
Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1949
Les armoiries sont des emblèmes en couleurs, propres à un famille, à une communauté ou, plus rarement, à un individu, et soumis dans leur disposition et dans leur forme à des règles spéciales, qui sont celles du blason. Certaine caractères distinguent nettement les armoiries du moyen-âge des emblèmes préexistants. Servant le plus souvent de signes distinctifs à des familles, à des groupes de personnes unies par les liens du sang, elles sont en général héréditaires. Les couleurs dont elles peuvent être peintes n'existent qu'en nombre limité. Enfin, elles sont presque toujours représentées sur un écu.
Rémi Mathieu. Le système héraldique français
» Toutes les citations relatives au blason et à l'héraldique
L'héraldique est le livre illustré de l'Histoire. Les signes, les couleurs rappellent les faits et gestes de ceux qui nous ont précédés. Ils sont un défi pour le présent et l'avenir.
SAI&R l'Archiduc Otto de Habsbourg (1912),
Préface de Les dynasties d'Europe, éd. Bordas.
Je revoyais les armoiries qui sont peintes aux soubassements des vitraux de Combray et dont les quartiers s'étaient remplis, siècle après siècle, de toutes les seigneuries que, par mariages ou acquisitions, cette illustre maison avait fait voler à elle de tous les coins de l'Allemagne, de l'Italie et de la France : terres immenses du Nord, cités puissantes du Midi, venues se rejoindre et se composer en Guermantes et, perdant leur matérialité, inscrire allégoriquement leur donjon de sinople ou leur château d'argent sur fond d'azur.
Marcel Proust (1871-1922), Le Côté de Guermante
Blason. s. m. Armoirie, assemblage de tout ce qui compose l'écu armorial. Sur les anciens tombeaux, on trouve les blasons de plusieurs maisons illustres.
Il se dit aussi de la connaissance de tout ce qui est relatif aux armoiries. Entendre le blason. Savoir le blason. Enseigner le blason. Les règles du blason. Armoiries qui sont contre les règles du blason.
Dictionnaire de l'Académie française (6e éd. 1832)
L'histoire du blason, mais c'est l'histoire toute entière de notre pays !
E. Jouffroy d'Eschavannes (1820- )
La connaissance du blason est la clé de l'histoire de France.
Gérard de Nerval (1808-1855), Angélique
Pour qui sait le déchiffrer, le blason est une algèbre, le blason est une langue. L'histoire entière de la seconde moitié du moyen-âge est écrite dans le blason, comme l'histoire de la première moitié dans le symbolisme des églises romanes. Ce sont les hiéroglyphes de la féodalité après ceux de la théocratie.
Victor Hugo (1802-1885), Notre-Dame de Paris
Cet écu ravirait un amateur de l'art héraldique par une simplicité qui prouve la fierté, l'antiquité de la famille. Il est comme au jour où les croisés du monde chrétien inventèrent
ces symboles pour se reconnaître, les Guaisnic ne l'ont jamais écartelé, il est toujours semblable à lui-même, comme celui de la maison de France, que les connaisseurs retrouvent en abîme ou écartelé, semé dans les armes des plus vieilles familles.
Honoré de Balzac (1799-1850), Béatrix
Le Blason est la langue la plus étendue, la plus riche, la plus difficile de toutes ; une langue rigoureuse et magnifique, ayant sa syntaxe, sa grammaire, son orthographe.
Bernard Germain Étienne de Laville-sur-Illon, comte de Lacépède (1756-1825), Histoire générale physique et civile de l'Europe.
Gardons-nous
de mêler le douteux au certain, et le chimérique avec le vrai.
Voltaire (1694-1778), Essai sur les moeurs.
Quelle est la roture un peu heureuse et établie à qui il manque des armes, et dans ces armes une pièce honorable, des supports, un cimier, une devise et peut-être un cri de guerre ? (…)
Il reste encore aux meilleurs bourgeois une certaine pudeur qui les empêche de se parer d'une couronne de marquis, trop satisfaits de la comtale.
Jean de La Bruyère (1645-1696), Les Caractères
…Maint esprit fécond en rêveries
Inventa le blason avec les armoiries.
Nicolas Boileau (1636-1711), Satires
Le Blason est une espèce d'Encyclopédie. Il a sa théologie, sa philosophie, sa géographie, sa jurisprudence, sa géométrie, son histoire et sa grammaire.
Père Claude-François Ménestrier (1631-1705), Art du Blason simplifié. 1661
Celui qui désiroit de monstrer sa vertu
Portoit sur le harnois dont il estoit vestu
Ou dans son bouclier une recognoissance
A fin que par la presse on congneust sa vaillance
Un avoit un serpent, l'autre avoit un lion,
Un aigle, un léopard… Ainsi un million
Par les siècles passés d'enseignes sont venues
Que les races depuis pour signes ont retenues.
Pierre de Ronsard, 1524-1585, Épitre à Renée de Sanzay
Qui n'a pratiqué l'Office d'armes par trente ou quarente ans continuels, il y a matière d'apprendre d'autant que c'est un Pérégrin non connu à tous, quelques doctes et versés qu'ils soient ès Droicts et Loix.
Jean Scohier, Estat et Comportement des Armes
Qui vous meut ? Qui vous poinct ? Qui vous dict que blanc signifie foy et bleu fermeté ? Un, dîtes-vous, livre treplu... le blason des couleurs. Qui l'a fait ? Quiconque il soit, en ce a esté prudent, qu'il n'y a point mis son nom. Mais au reste, je ne sçaiy quoy premier en lui je doive admirer, ou son outrecuidance, ou sa bêterie.
François Rabelais (v. 1494-1553), Gargantua
 La qualité de gentilhomme a été tellement en estime en France que les Rois juraient souvent par la foi de gentilhomme, et qu'ils considéraient ce serment comme renfermant toutes les vertus qui devaient le rendre inviolable. La qualité de gentilhomme a été tellement en estime en France que les Rois juraient souvent par la foi de gentilhomme, et qu'ils considéraient ce serment comme renfermant toutes les vertus qui devaient le rendre inviolable.
Saint-Allais, Ancienne France
Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles ; sur les terres ils avaient mis des noms.
Psaume 49, 12
» Toutes les citations relatives à la noblesse
Nous savons qu'une révolution sociale s'est accomplie sans retour, que les hommes n'ont plus d'autre valeur que celle qu'ils tirent de leur mérite personnel, mais nous croyons que les familles, comme les nations, doivent conserver leur histoire, et ne pas répudier l'héritage que leur a légué le passé. Les grands exemples de courage, de vertu ou de dévouement contiennent des enseignements qui ne sont jamais perdus. En voyant ce qu'ont fait leurs pères, ceux dont l'unique privilège consiste à parler des noms déjà honorés, ne comprendront que mieux les devoirs qu'ils ont à remplir envers la société nouvelle, et ils se garderont d'oublier le vieil adage « Noblesse oblige ».
Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne
La vraie incommunicable noblesse subsiste toujours et ne peut manquer de se relever... lorsque le lustre de la naissance sera soutenu par un véritable mérite.
Comte de Boulainvillers, Essai sur la noblesse
Un nom historique est une grandeur ; et le respect de la gloire passée prend sa source dans de nobles sentiments.
Royer-Collard
Si le passé des grandes familles fait […] partie de la gloire nationale, leurs descendants ne peuvent en retenir une part qu'à la condition de se rendre personnellement digne de leurs aïeux.
Docteur de La Mare, Union, 10 février 1861
Comment est-il possible, dans un État bien réglé, et quand l'existence de la noblesse est consacrée par la constitution elle-même, que le premier venu puisse à son gré s'affubler de titres auxquels il n'a pas droit ; que pour satisfaire à des convenances prétendues de famille, de fortune, de position, sans autre règle que son caprice, il s'intitule baron, comte, marquis ?
Premier président Delangle, Rapport au Sénat, 28 février 1855
Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères,
Pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères !
De la plupart des gens c'est la démangeaison,
Et, sans vous embrasser dans la comparaison,
Je sais un paysan qu'on appelait Gros Pierre,
Qui, n'ayant pour tous bien qu'un seul quartier de terre,
Y fit tout à l'entour faire un fossé bourbeux,
Et de Monsieur de l’lsle en prit le nom pompeux.
Molière, École des Femmes
|



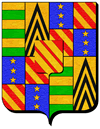
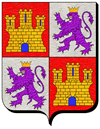
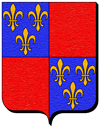
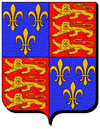
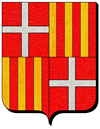
 La qualité de
La qualité de